L’orgue et l’absolution
Une soirée dans l’antre de Diogène
Petit conte oriental
L’orgue et l’absolution
Feu Monsieur le Comte, Père de Monsieur le Comte était, outre un administrateur chevronné qui tenait son domaine de main de maître, un grand fripon.
Madame la Comtesse avait une camériste nommée Margot, mère d’une jeune adolescente fort jolie. Cette jeune Madeleine, dite Linette, avait été placée, à l’âge de treize ans, dans une famille de petite noblesse amie de la Comtesse pour servir de nurse à ses deux enfants. Monsieur le Comte rendait souvent visite à Monsieur le Baron, patron de Linette, avec lequel il partageait, outre la passion de la chasse, celles, moins nobles, du bon vin et des jolies femmes.
Les années passant, Linette devint un beau brin de fille un peu plantureuse comme on les aimait à cette époque, qui n’avait ni les yeux ni la langue dans sa poche. On lui prêtait diverses aventures avec le palefrenier et autres marmitons de la propriété, mais tout ceci, bien entendu, n’était que ragots et vilaines jalousies, car Linette était en réalité sage comme une image, chaperonnée de près par Madame la Baronne. Un jour où cette dernière s’était absentée avec les enfants, laissant sa nurse au château, la jeune fille, allez savoir pourquoi, se trouva seule pour recevoir Monsieur le Comte et lui faire, en attendant le retour de ses Maîtres, les honneurs de la maison. Comment le bougre s’y prit-il pour séduire la mignonne ? Nul ne le sut jamais – à l’exception du Jérôme, jeune mitron effronté caché derrière un volet, qui avait assisté à la scène, furieux et jaloux, mais qui n’en dit jamais mot à quiconque- Toujours est-il que le résultat ne se fit pas attendre et que, Madame la Baronne, voyant avec effroi sa nurse prendre de l’embonpoint et être peu à peu précédée d’un bidon proéminant, la questionna avec force autorité afin qu’elle lui livrât le nom du responsable de ce désastre. La pauvrette, en larmes, supplia Madame la Baronne de ne pas dévoiler ce secret et finit par passer aux aveux.
—Mon Dieu ! S’écria Madame la Baronne, une main sur le front, l’autre sur le cœur. Ma pauvre fille, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait là ? Et que va en penser Madame la Comtesse qui, elle aussi, est enceinte pour la troisième fois des œuvres de ce coquin ?
— Il ne faut pas le dire à Madame la Comtesse, Madame, je vous en prie, ne dites rien. Ma mère sera jetée dehors. Que deviendrions-nous ?
—Que nenni, ma fille ! Madame la Comtesse sera avisée, sois en sûre ! Quant à toi, je suis au regret de te dire que tu vas devoir quitter séant ce toit où nous t’avons nourrie toutes ces années durant ! Ah ! Je suis triste, vois-tu ! Si triste ! Conclut la Baronne en tournant le dos à la pauvre Linette désespérée, qui s’en alla derechef à sa chambre préparer son bagage et dire adieu aux enfants avant de quitter cette maison où elle avait été somme toute heureuse et avait appris tant de bonnes manières.
Bien entendu, Monsieur le Baron fut immédiatement mis au courant. Indulgent, et pour cause, envers son vieil ami, il décida de trouver un arrangement à la chose et convia Monsieur le Comte à une chasse pour discuter entre hommes de la conduite à tenir. Il faut dire qu’à cette époque, il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’une certaine catégorie de messieurs aient une ou même plusieurs maîtresses. Mais pas au point d’engrosser la nurse de ses amis, tout de même !
Il fut décidé, pour couper la poire en deux, que Madame la Comtesse serait informée de la faute de Linette sans pour autant l’être de l’identité du coupable et, Margot étant devenue depuis longtemps indispensable auprès d’elle, surtout maintenant qu’elle était enceinte, on la garderait à son service et on lui adjoindrait Linette pour s’occuper de l’enfant à naître : jeune accouchée elle-même, Linette pourrait allaiter les deux bambins.
Ainsi fut fait. Madame la Comtesse, à qui on conta, sans donner de détail, la faute de Linette, reçut la nouvelle en pinçant le bec de réprobation, mais, bonne chrétienne, elle se montra charitable et donna ordre qu’on l’installa dans la chambre de sa mère. Margot, compatissante envers sa fille pour avoir subi le même sort, car Linette était le fruit de ses amours adultérins avec son ancien maître, la recueillit avec la rude tendresse dont elle avait toujours fait preuve à son égard. La grossesse de la jeune femme était à peu près aussi avancée que celle de la Comtesse. Elle accoucha quelques semaines plus tard en criant et pestant contre l’artisan de son malheur tandis que la cuisinière du château, promue sage-femme à chaque naissance des alentours, l’encourageait :
—Gard’ donc ton souffle pour pousser, ma fille. Allez, pouss’ donc. Par où il est entré faut ben qu’il sorte ! Et puis tu verras : mal d’enfantement, c’est mal joli, sitôt fait, on en rit. Allez, pous’ ! le v’la qui vient !
Un beau garçon dodu vit le jour trois semaines avant que Madame la Comtesse mit au monde son fils, bien plus chétif que celui de Linette, avec force cris et larmes, car il était de bon ton, lorsqu’une Dame de la Société accouchait, qu’elle montrât l’ampleur des douleurs de l’enfantement, conformément aux Lois de l’église : « tu enfanteras dans la douleur ».
Le premier né fut nommé Pierre Gaillard, de père inconnu ; le jeune Comte, Charles, Henri, Joseph de la Mirebaude. Les deux demi-frères devinrent frères de lait, élevés aux seins de Linette.
Les deux bambins profitaient et, en grandissant, quelques ressemblances commençaient à apparaître. Pierre, surtout, avait la constitution solide de son père, alors que Charles, plus fragile, avait celle de sa mère. Pierre avait le regard brun de son père alors que Charles avait celui, gris, de sa mère. Malgré ces différences, des traits de visage leur étaient communs, ainsi que la couleur des cheveux. Ces similitudes n’échappaient à personne et on les attribua au fait que les deux enfants étaient nourris au même lait. Le temps passant, la chose devint de plus en plus évidente et, Madame la Comtesse, qui n’était tout de même pas complètement idiote, remarquait entre le fils de Linette et Monsieur le Comte beaucoup plus de ressemblance que ne pouvait en expliquer l’allaitement. Ayant eu vent de certains écarts de conduite passés de son mari, le doute commença à l’assaillir et la puce à lui venir à l’oreille. Lui avait-on caché quelque chose ? Elle se mit en tête de faire parler Margot qui, n’ayant jamais pu garder un secret, finit par vendre la mèche en reniflant, pleurant et suppliant Madame de ne rien en dire à Monsieur, de ne pas punir Linette.
—Surtout, disait-elle, que la pauvre enfant n’avait pas su c’qui lui arrivait et n’avait pas su r’mettre M’sieur l’Comte à sa place, lui qu’avait si éhontément profité d’son innocence. Et que, depuis, elle mettait tout en œuvre pour ne pas s’trouver seule en sa présence, mêm’ lorsqu’il entrait sans prév’nir dans la nurserie d’où elle ne sortait qu’ pour prom’ner les enfants dans l’parc, la pauvrette, à cet’heur !;
Madame la comtesse s’en alla derechef confesser son infortune au curé et lui demander conseil. Celui-ci, qui voyait là une situation dont il pourrait tirer avantage, d’un ton paternel lui recommanda de ne pas faire de scandale mais de mettre les points sur les « i » à son mari, certes avec tout le respect qu’une épouse de sa condition devait à son époux, mais aussi fermement que son état l’exigeait.
—Dieu, lui dit-il, vous envoie une épreuve, mon enfant, dont vous pourrez sortir victorieuse car vous êtes une femme de bon sens. Votre piété sera reconnue. Les dessins du Seigneur sont impénétrables, voyez-vous, et je suis sûr que ce malheur qui vous frappe aujourd’hui sera récompensé dans l’avenir.
Il fallait avant tout éviter que Monsieur le Comte ait des velléités de séduire à nouveau cette pauvre Linette et s’assurer que cette dernière n’en n’éprouvait pas davantage de désir. Peut-être faudrait-il faire sortir le loup de la bergerie en renvoyant la mère et l’enfant ? Mais il faudrait alors s’assurer que ces pauvres êtres ne soient pas jetés sur les routes, misérables et dépourvus de tout… C’était, dans son âme et conscience, à Madame la Comtesse de décider… Mais il fallait aussi que Madame la Comtesse impose à son époux l’obligation de réparer sa faute envers elle, épouse bafouée… En conclusion, Madame la Comtesse reçut la bénédiction du curé qui ne manqua pas, en la raccompagnant, de lui rappeler d’une voix doucereuse et pleurnicheuse :
—Vous savez, Madame, que notre église n’a plus d’harmonium ; le précédent est trop abimé, il n’est pas possible de le réparer. Hélas, La quête rapporte plus de boutons de culotte que de monnaie et quand on donne, c’est rarement plus d’un ou deux sous ! Si Monsieur le Comte avait la bonté d’intervenir auprès de notre Evêque qu’il connaît bien…
—C’est entendu, Monsieur le curé, comptez sur moi, je vais faire le nécessaire, répondit Madame la Comtesse en le saluant.
Le discours du curé n’avait guère aidé Madame la Comtesse, mais l’avait amenée à réfléchir avant de prendre une décision quant à l’attitude qu’il convenait d’adopter. Envers son mari, d’abord, à qui il fallait montrer que, bien que docile et effacée, elle n’avait pas l’intention de prêter le flanc sans rien dire. Elle entrevoyait là un moyen de le faire plier à lui accorder quelques avantages matériels et moraux en lui démontrant que, blessée dans son amour pour lui et dans son amour propre, elle était capable de mansuétude et de pardon. Envers Linette, ensuite, dont elle répugnait à se séparer car elle avait des qualités qu’il était assez rare de trouver chez une nourrice. Dévouée, toujours attentive et affectueuse, on pouvait lui confier les enfants en toute sérénité. De plus, la jeune femme n’était pas exigeante, ne demandait jamais de jour de congé et ne quittait la maison qu’accompagnée de sa mère. On pouvait à loisir observer ses moindres faits et gestes, ce qui éloignait tout risque . Elle convoqua Margot et acheta définitivement son dévouement par le chantage suivant :
—Ma bonne Margot, je vous garderai, Linette et toi à mon service, aussi longtemps que j’aurai l’assurance que Monsieur le Comte ne lui tournera pas autour. Au moindre doute, je vous jetterais toutes les deux dehors avec l’enfant et je ferais en sorte que vous ne soyez prise au service d’aucune bonne maison dans la région. Je compte donc sur toi pour que tout aille bien, car je tiens à toi et Linette m’a donné, jusqu’à présent, toute satisfaction dans son service. J’avais auparavant décidé que son garçon serait élevé dans cette maison et recevrait la même éducation que mon fils, le temps qu’elle resterait à mon service, ce qui est inespéré pour un enfant de sa condition ! Cette situation nouvelle, je te l’avoue, a failli me faire changer d’avis, mais j’ai bien réfléchi. Je considère qu’il serait injuste que cet enfant pâtisse des erreurs de sa mère en étant jeté avec elle dans une vie misérable. Mon mari a commis une faute, soit. Je pense qu’il doit réparation…Ceci dit, je désire que Linette ne soit pas mise au courant de ce que je viens d’apprendre, ni de cette conversation. Arrange toi donc pour que jamais elle n’ait vent de mon sentiment et de mes intentions. Et surtout, n’ayez, ni l’une ni l’autre, l’espoir que le petit Pierre ne puisse jamais prétendre à quoi que ce soit de plus.
Margot écoutait sa patronne en se tordant les mains et en reniflant, partagée entre le désir de se révolter contre un tel chantage et celui de lui exprimer toute sa reconnaissance devant tant de mansuétude inattendue et, il faut bien le dire, inhabituelle à cette époque où il n’était fait que peu de cas des bons sentiments à l’égard de celles qu’on appelait « les bonniches » ! Elle prit le parti le plus sage :
—Madame la Comtesse est ben bonne ! J’ vous r’mercie ben, Madame la Comtesse et j’ vous fais la promesse de fair’ comm’ vous m’le d’mandez, Madame, répondit-elle en reniflant.
— C’est bien, Margot. Allez, sèche tes larmes, à présent et vas dire à Monsieur le Comte que j’ai à lui parler.
Margot, en allant quérir Monsieur le Comte, se disait qu’il allait y avoir une sacrée explication et qu’il ne ferait pas bon trainer dans les parages pendant et après l’orage. Elle envoya Edgard, le cocher, qui attendait dans la cuisine devant un verre de café, chercher son patron et, saisissant une panière de linge que la lavandière venait de déposer à l’office, elle alla s’enfermer dans sa lingerie.
Nul bruit, nul éclat de voix ne sortit de la chambre de Madame la Comtesse. Personne, à part Margot, n’avait pu savoir ce qui s’était dit, ce jour-là, entre les époux de la Mirebaude. Le lendemain, Monsieur le Comte partait pour un voyage dont il ne revint que trois semaines plus tard. La vie reprit normalement au château, comme si de rien n’était.
Quelques mois après le retour de Monsieur le Comte, une grosse carriole tirée par deux chevaux arriva au village. Elle transportait quelque chose de très volumineux sous des bâches arrimées avec des cordes. Ce convoi s’arrêta devant l’église où Monsieur le curé semblait l’attendre, portes grandes ouvertes. Quatre gaillards descendirent de la carriole et s’activèrent, déchargeant et entreposant tout un fatras d’objets sur la mezzanine, aidés de la voix par le curé qui virevoltait autour d’eux, la soutane retenue à la taille par une épingle à linge, les manches remontées à mi bras. Il s’agitait en tous sens, comme si dix boisseaux de puces lui piquaient le derrière. Ce déchargement terminé, on ferma les portes de l’église. Une grande bâche fut tendue de part et d’autre de la mezzanine pour la cacher aux regards et les quatre gaillards disparurent derrière cet écran. Pendant plusieurs jours, on entendit des grincements et des coups de marteaux sans que personne ne puisse deviner la nature des travaux engagés dans l’église.
Le dimanche suivant, il y eut plus d’ouailles à la messe qu’habituellement, la curiosité, sans aucun doute plus forte que la foi, ayant amené là les villageois et leurs voisins. On s’interrogeait, on se perdait en conjectures, on espérait que le curé, pendant son sermon, informerait ses ouailles de ce qui se passait dans son église. Pas un mot d’explication ne sortit de sa bouche pour calmer les interrogations mais, surpris par l’affluence record de ce dimanche, il ne put tout de même pas s’empêcher, au début du prêche, de dire, avec une petite touche d’ironie et d’humour, qu’il était bien heureux de constater que sa messe était mieux fréquentée ce matin-là que l’auberge !
Quelques jours plus tard, en plein marché, des sons inhabituels s’envolèrent de l’église. Des grincements aigus à vous faire tomber les dents figèrent sur place les forains et leurs clients. Que se passait-il dans cette église ? Le curé se battait-il avec le diable ? Les cloches étaient-elles en train de se détacher ? Des sueurs froides et des frissons glacés envahirent les plus superstitieux qui détalèrent la peur au ventre. Puis, de plus en plus précis jusqu’à s’approcher de la gamme, les sons devinrent plus harmonieux et, enfin parfaitement accordé, l’orgue fit entendre une suite mélodieuse de notes déferlantes. Enfin, un requiem s’éleva, envahissant la place tout entière et les rues avoisinantes. Les conversations se turent. Mademoiselle Raymonde, la bonne du curé, catéchiste et organiste -elle tenait l’harmonium les jours de cérémonie-, crut à un miracle, se mit à invoquer la Sainte Vierge et se précipita vers la porte de l’église contre laquelle elle faillit se casser le nez, car elle était verrouillée de l’intérieur.
Cette nouvelle fit vite le tour du bourg et l’on vit, tout au long de la journée, les curieux s’amasser devant l’église, faisant mille commentaires et suppositions. Quelques-uns de ceux qui avaient entendu cette sérénade affirmaient qu’il s’agissait là de la musique d’un orgue, « vu qu’c’était pareil que pour le mariage, ou la communion d’untel, dans la cathédrale de Niort ou d’ailleurs ». Mais, comment le curé aurait-il pu faire installer un orgue, lui qui n’avait jamais pu obtenir qu’on réparât le clocher qui menaçait ruine ?
Monsieur le curé finit par paraître sur le parvis et, avant d’être assailli, se mit à claironner :
—Dimanche prochain, venez donc aussi nombreux que dimanche dernier assister à la messe de 11 heures !
Le dimanche suivant, donc, bien avant l’heure, une foule nombreuse attendait déjà sur la place. Les cloches carillonnaient à se fendre, tirées par les enfants de chœur dont le jeu favori était de se suspendre à la corde qui les actionnait, s’envolant en faisant virevolter leur aube gonflée comme une montgolfière, tapant le sol des pieds lorsque la corde redescendait pour monter encore plus haut à chaque envolée. A onze heures précises, les portes de l’église furent ouvertes et les fidèles conviés à y pénétrer. Tous se précipitèrent à l’intérieur, cherchant du regard ce qui avait bien pu changer. Rien, à première vue, ne leur apparut. Soudain, un Salvé Regina éclatant s’éleva dans la nef, faisant sursauter l’assistance qui, le nez en l’air, découvrit avec la surprise qu’on imagine l’orgue et ses tuyaux, adroitement activé par un personnage inconnu qui n’était autre que le facteur d’orgue, celui-là même qui resta logé au château le temps nécessaire pour initier Mademoiselle Raymonde à jouer de cet instrument dont elle ne tira malheureusement jamais de sons aussi mélodieux que cet homme -D’aucuns racontèrent même , voyez donc où va s’nicher la malice, qu’il initia la dame patronnesse, demoiselle de son état, à d’autres musiques que celle d’église-
Sur le devant de l’appareil, on pouvait lire, gravé sur une plaque de laiton « don de Monsieur le Comte de la Mirebaude ». Monsieur le Comte avait ainsi obtenu l’absolution de Monsieur le curé en même temps que le pardon de Madame la Comtesse. La messe fut dite. On s’inclina avec respect devant Monsieur le Comte et Madame la comtesse. On baptisa le jeune comte, on bénit l’orgue si généreusement offert en échange d’une absolution et d’un pardon.
Pierre fut baptisé à la hâte, à l’écart.
—C’est qu’ malheur, un’ fill’ mère et son batard, à cet’heur’ ! Dirent les commères.
—Pauv’ petite. Soupirèrent les bigotes.
—Ben ! Pensait le Jérôme, quand on a des sous, on peut ben engrosser tout l’village, personne y voit ren à r’dire ! Si j’étions l’père d’ce batard là, l’aurait ben fallu que j’l’épousions la Linette et y’aurait pas eu d’orgue, pour sûr !
Les deux garçons furent élevés ensemble jusqu’à l’âge de 12 ans. Pierre reçut la même instruction que le jeune comte par les cours que le précepteur, Monsieur Clément, venait leur prodiguer quatre jours par semaine. Ils apprirent le catéchisme avec Monsieur le curé et Mademoiselle Raymonde, firent ensemble leur communion et passèrent leur certificat d’études. Le jeune Charles fut pensionnaire au collège à Bordeaux, puis partit à l’Académie militaire alors que Pierre, resté au château, apprenait, sous les directives de Gerbaud le métayer, le travail de la terre. Entre temps, Linette épousa le Jérôme qui reconnut Pierre, le délivrant de sa condition de bâtard. Il eut trois frères et une sœur, tous élevés au château et employés ou placés par Monsieur le Comte. A la mort de Gerbaud, Monsieur le Comte installa Pierre sur des terres dont il lui fit cadeau et lui donna l’emploi de métayer de la propriété.
Lorsque Charles se retira au château, après la mort de ses parents, la relation des deux hommes, bien que respectant les distances d’usage à cette époque, restèrent malgré tout très proches. On ne sut jamais s’ils connurent leur parenté mais Pierre fut tué à la guerre et Charles, de retour sain et sauf, veilla à ce que sa femme et leurs quatre enfants ne manquassent jamais de rien.
Une soirée dans l’antre de Diogène
Cette nouvelle a reçu le deuxième prix section nouvelles au Concours international de littérature 2022 d’Arts et Lettres de France.
Les gens comme tout le monde ne présentent aucun signe particulier, on ne les remarque pas ; ce sont des gens ordinaires, dans la bonne moyenne. Régis était ce ceux-là. Le croisant à bonne distance, vous ne l’auriez pas remarqué, mais, le frôlant, une particularité olfactive aurait attiré votre attention car il dégageait une odeur qui ne pouvait échapper à aucun nez, même des plus bouchés. Votre regard se serait attardé un instant sur sa personne mais vous auriez cherché à vous en éloigner pour échapper à ces effluves désagréables. Pourtant, le personnage n’était pas dépourvu d’intérêt. Grand amateur de littérature, il avait une belle érudition qui pouvait tenir son auditoire en haleine sur bien des sujets. Pourvu d’un sens de l’humour certain, il n’engendrait ni la tristesse ni la mélancolie et, malgré sa puanteur, il comptait de nombreux amis.
Propriétaire d’une belle propriété perchée sur une hauteur dont la vue sur les monts d’Auvergne était imprenable, il attirait un grand nombre de visiteurs qui, dès leur arrivée aux abords de la demeure, pouvaient se faire une idée édifiante quant à sa manière d’appréhender l’ordre des choses.
La première difficulté était de garer son véhicule sur un terre-plein en principe réservé à cet effet mais dont l’espace était en grande partie occupé par les matériaux d’un chantier abandonné, livrés aux herbes folles. Venaient ensuite le jardin, en friche, la piscine, vide d’eau mais emplie de débris, la terrasse, encombrée d’objets disparates. L’ensemble laissait présumer de l’état général du logement.
Une grande salle de séjour, qui avait dû connaître des jours meilleurs, ouvrait par quatre baies vitrées sur la terrasse. En franchissant le seuil, le visiteur découvrait l’inimaginable bric à bric qui régnait en ces lieux.
Les baies vitrées, obscurcies par des années de chiures de mouches et autres salissures, étaient voilées de mousselines et de tentures défraichies, en lambeaux, qui pendouillaient lamentablement aux endroits où les accroches avaient cédé ; un amoncellement d’objets hétéroclites, dans tous les coins de la pièce, semblait être le témoin d’un passé dont les effets restaient indélébiles. Telles les offrandes autour du tombeau d’un pharaon, le maître de maison avait entassé souvenirs, paperasses, emballages, bouteilles vides, morceaux de bois et mille autres choses couvertes de poussières et devenues inutiles comme témoignages d’une vie qui s’écoule sans pouvoir rien en effacer, comme pour se prouver qu’hier fut et que demain laissera assez de traces pour que le souvenir demeure. Cet homme semblait s’enterrer peu à peu sous le poids de son existence, refusant le vide que l’ordre risquerait de creuser, le désordre et la crasse accumulés lui servant de bouclier contre la solitude et les servitudes du quotidien.
« Hier ressemble à aujourd’hui et demain sera semblable aux jours précédents » pouvait être sa devise. Seul, l’apport d’un nouveau désordre les différencierait, qui ajouterait une difficulté supplémentaire à se mouvoir dans sa maison, à trouver une place à un nouvel objet ou à un déchet de plus.
Dès le premier instant on descellait, dans son regard, dans ses attitudes, dans la façon dont il se passait une main sur les yeux lorsque la discussion s’animait, une tristesse dont on ne pouvait soupçonner l’origine ni l’intensité. Le délabrement qui gagnait peu à peu l’ensemble de son habitation semblait être à l’image de son existence, témoignage de son refus d’y changer quoi que ce soit, de son consentement du chaos qui l’entraînait inévitablement. Pourtant, cet homme était un artiste. Il s’adonnait à la peinture, réalisant sur la toile des œuvres d’un grand niveau artistique, époustouflantes de beauté, comme en témoignaient celles accrochées sur l’unique mur du salon laissé libre à cet effet. Le seul endroit bénéficiant d’un peu d’organisation était la partie de la salle de séjour où il avait installé ses chevalets et ses tubes de peinture, bien alignés sur un pupitre dans l’ordre des couleurs allant du plus foncé au plus clair. Les pinceaux, propres et classés par forme et épaisseur étaient, quant à eux, disposés dans des bocaux de verre.
Curieusement, en ce lieu tourmenté, aucune émanation nauséabonde particulière ne choquait l’odorat, comme si son propriétaire en était l’unique réceptacle, ne laissant à son capharnaüm que l’entassement des poussières et s’en réservant les remugles. L’odeur dominante, pour peu qu’on s’éloigne de lui, était une fragrance issue du mélange de l’essence de térébenthine dont il usait pour nettoyer ses pinceaux et de l’huile de lin avec laquelle il diluait ses pigments, mêlée aux relents âcres de la poussière qui virevoltait dans l’air en myriades de particules tourbillonnantes.
Invitée par un ami commun, je découvris cet endroit surréaliste avec la curiosité du néophyte et j’y passai une soirée inoubliable en compagnie de gens tout aussi surprenants que notre hôte, artistes quelque peu déjantés et lui, porteur d’une folie douce, convivial, débonnaire et à la générosité sans limite. Il m’avait accueillie à bras ouverts, célébrant notre toute nouvelle amitié en m’offrant l’hospitalité sous son toit dont le désordre et le manque d’hygiène ne pouvaient qu’étonner et choquer le visiteur ; pourtant aucune gêne, aucun complexe devant ces incongruités ne semblaient l’affecter. De nouveaux convives arrivant, c’est avec le plus grand naturel et beaucoup d’humour qu’il leur ouvrit sa porte, offrant gîte et couvert à qui voulut bien se donner la peine de fermer les yeux sur l’immense foutoir qui régnait dans son antre.
Nous fûmes une quinzaine d’invités autour de sa table qu’il nous fallut débarrasser et nettoyer. Nous déplaçâmes de là, outils, bouquins, restes d’un repas précédent et objets divers pour les entasser ailleurs, avant d’y installer couverts et assiettes soigneusement rangés dans le seul meuble de la pièce n’ayant pas souffert de son désir d’envahissement. Les verres en cristal étaient parfaitement propres et bien alignés, la tête en bas « pour éviter que la poussière n’entre à l’intérieur » spécifia-t-il d’un air docte, les assiettes et les plats de porcelaine blanche rangés par taille. Ces détails m’intriguèrent, ce souci de propreté et de rangement ne collaient décidément pas avec l’ambiance générale.
Furetant de ci, de là à la recherche d’un coin intime, je m’étonnai, à chaque découverte, du ramassis invraisemblable de vieilleries envahissant l’ensemble des pièces. Je trouvai enfin les toilettes dont l’hygiène douteuse n’invitait pas à une utilisation sereine ; les emballages et rouleaux de carton usagés s’amoncelaient dans le lave-mains rendu inutilisable ; la salle de bain n’avait rien à envier ; la baignoire, encombrée de linges douteux, la douche servant de placard fourre-tout, le lavabo, également empli d’un bric à brac de flacons usagés, ne permettaient pas davantage qu’on puisse s’y rafraîchir.
Pourtant, je décelai, dans ce bric à brac, une relative volonté de classement. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce capharnaüm semblait résulter d’une certaine organisation. Chaque désordre occupait le lieu qui lui revenait avant d’avoir atteint l’état de rebut, dans les toilettes comme dans la salle de bain. Dans le bureau, des papiers s’éparpillaient pêle-mêle couvrant le clavier de l’ordinateur, des dossiers jonchaient le sol, entassés en pyramides château-branlant qu’il fallait enjamber pour se frayer un passage jusqu’à une table de travail encombrée d’un fouillis de corbeilles débordant de documents. Cependant, ce qui devait être dans le bureau était dans le bureau. Il en allait de même dans chaque pièce, dans chaque chambre, envahies, surchargées, mais toujours accessibles. Le salon regorgeait de bibelots disposés pêle-mêle sur des étagères poussiéreuses et le piano, désaccordé à en faire grincer les dents, disparaissait sous un amas de partitions jaunies ; les canapés et les fauteuils étaient délabrés et salis de taches indélébiles, mais tout ceci figurait à la bonne place. La cuisine allait de pair avec le reste. Un entassement de vaisselles salles encombrait l’évier, les appareils électro-ménagers débordaient d’une crasse graisseuse accumulée depuis des années, des sacs poubelle à demi remplis étaient éparpillés dans chaque coin, mais ce qui appartenait à la cuisine était au bon endroit.
« L’ordre dans le désordre », pensai-je.
Ce manque d’hygiène me fit douter de la qualité des mets qui nous seraient servis et je dus me retenir de partir sur le champ, tant le dégoût me gagnait. Il me fallait faire preuve de politesse ; je fis contre mauvaise fortune bon cœur en proposant mon aide pour la préparation du repas, espérant pour le moins qu’il me serait possible de procéder au nettoyage des ustensiles et plats destinés à recevoir les aliments qui nous seraient servis. C’était sans compter sur l’entêtement du maître de maison qui refusa poliment mais fermement toute intervention féminine dans ce qu’il appelait pompeusement son laboratoire !
Le repas fut savoureux et se déroula dans la gaité ; les convives, insensibles au désordre et à la crasse, firent honneur au poulet de ferme savamment rôti, artistiquement découpé et parfaitement disposé sur un plat de porcelaine. La présentation et la saveur des mets me firent presque oublier le dégoût que j’avais ressenti et je me laissai emporter par l’ambiance et les conversations qui allaient bon train autour de la table.
Tout se déroula de la manière la plus joyeuse et conviviale jusqu’au dessert ; c’est ce moment, alors que nous allions déguster le gâteau offert par un convive, que choisit une amie de longue date de notre hôte pour formuler une remarque discrète sur l’état de sa maison due, le plaignit-elle, à sa vie solitaire ; elle lui proposa gentiment de lui consacrer quelques heures pour l’aider à remettre tout ceci en bon ordre. La réaction fut immédiate. Se levant d’un bond, Régis, avec le plus grand calme, yeux plissés et mains appuyées sur la table, la gratifia d’un sourire carnassier et déclina l’invitation :
« Ma chère Ghislaine, persifla-t-il, je te remercie beaucoup, mais si ma maison ne te plait pas dans l’état où elle se trouve, tu n’es pas obligée d’y rester. Je refuse qu’aucune petite main de fée vienne se mêler de mes affaires. Toute ma vie j’ai dû supporter une mère, puis une épouse passant leur temps à ranger, nettoyer, lessiver, faisant de ma vie un univers aseptisé sans aucun intérêt au nom de l’hygiène dont je me contrefous ! Quoi que tu en penses, ma crasse me tient chaud et mon désordre est mon ordre personnel. Je n’ai pas besoin d’une boniche. Je ne supporte les femmes que pour leur beauté et leur intelligence, c’est d’ailleurs pourquoi il n’y en a plus sous ce toit, car, c’est plus fort qu’elles, dès qu’elles entrent ici, elles veulent tout chambouler, consacrant plus de temps au ménage qu’à des activités ludiques et intéressantes, se transformant en Conchita au balais ravageur. Ça gâche le charme, ça me fait les regarder comme des domestiques et non comme des partenaires, ça me révolte ! Alors, non ! Encore merci, mais basta ! »
Ceci dit, il se rassit et leva son verre à l’amitié et à la beauté féminine.
Le silence s’était fait autour de la table ; interloqués, les convives n’osaient piper mot. La glace fut rompue par un applaudissement qui fusa du bout de la table, les verres se levèrent et l’ambiance retrouva sa gaité, malgré la gêne que certains s’efforçaient encore de cacher. Pour ma part, les paroles de notre hôte m’avaient apporté un début de réponse aux questions que je me posais ; je tournai mon regard sur Ghislaine ; piquée au vif, écarlate, elle avait du mal à retenir ses larmes. Elle quitta la table, prit son manteau et partit en faisant un signe d’aurevoir à la cantonade.
« Je crois que je viens de perdre une amie », releva simplement Régis en se servant un verre de vin.
Quelqu’un raconta une histoire drôle qui détourna l’attention de l’incident et la soirée se termina dans les rires, aidés par l’alcool coulant à flots. En fin de soirée, notre hôte était fin saoul. Il partit se coucher en titubant, marmonnant des choses incompréhensibles en faisant des moulinets avec les bras.
Nous étions quelques-uns à devoir passer la nuit dans cette maison. La chambre que je devais occuper, bien qu’ayant été balayée et nettoyée, ne m’attirait pas. Je ne pouvais m’empêcher de penser à toute cette poussière qu’avait soulevé le balai et qui restait suspendue dans l’air, au risque de m’étouffer pendant mon sommeil. D’ailleurs, personne n’avait envie d’aller se coucher, de peur de s’endormir dans la crasse. Réunis autour de la table, nous avons discuté jusqu’au matin en sirotant, pour nous tenir éveillés, moult tasses de café.
Lorsque notre hôte s’éveilla, il semblait en pleine forme et nous offrit un petit déjeuner que je refusai poliment, prétextant devoir rentrer de toute urgence à Paris où j’avais un rendez-vous dans le courant de l’après-midi. Il n’insista pas et, prenant congé, il formula une manière d’excuse :
« Je sais, je sais, me dit-il. Aucune femme ne pourrait supporter ça. Je les ai toutes fait fuir et c’est très bien. Je préfère la compagnie de mes vieilleries, mon désordre et ma solitude à la sollicitude d’une emmerdeuse. »
Je ne sus que répondre ; la tristesse de son regard semblait démentir ses propos ; je pensai qu’un tel mal être était en effet aussi insupportable que le désordre qu’il générait. Je le remerciai pour son accueil et, avant qu’il n’ait l’idée de m’embrasser, je luis tendis la main de peur d’être écœurée de si bon matin par son odeur que je percevais déjà.
Plus tard, on me confia que ce pauvre homme avait connu de grands déboires au cours de sa vie ; depuis, il n’était plus le même. Je ne sus pas quels malheurs l’avaient frappé mais je doutais qu’ils fussent la seule cause de son désordre et de sa puanteur.
J’appris, quelques mois plus tard, l’incendie de sa maison dont il ne restait que des ruines calcinées. Le mystère demeurait sur l’origine du désastre. Les décombres, fouillés, ne révélèrent pas le moindre indice prouvant qu’il avait péri au milieu de son désordre. On en conclut qu’il avait volontairement mis le feu à sa demeure et s’était enfui.
Plusieurs années s’étaient écoulées lorsque des randonneurs firent la découverte macabre d’un squelette dans un refuge de montagne si isolé que personne ne s’y était aventuré depuis fort longtemps. Il gisait, recroquevillé au milieu d’un amas d’objets hétéroclites, de toiles peintes, de pinceaux et de tubes de couleurs que les rongeurs et les insectes avaient grignoté, n’en laissant que quelques lambeaux. Malgré le temps passé, la puanteur de la masure était persistante. On sut qu’il s’agissait de Régis grâce à une carte d’identité à moitié rongée mais encore lisible.
Avait-il été assez désespéré pour se donner la mort, submergé par le poids de ses souvenirs et de ses regrets ou bien avait-il péri par excès de crasse et de solitude ?
#retour
Petit conte oriental
Attention : quelques situations, expressions et allusions « coquines » ne sont pas adaptées à la lecture pour enfants.
POUR RÉTABLIR LA VÉRITÉ SUR LES PRINCES CHARMANTS…
Il était une fois un gentil prince charmant beau, riche et intelligent, qui fut transformé en vilain crapaud par une méchante sorcière…
Ce conte a reçu le troisième prix section contes au Concours international de littérature 2021 d’Arts et Lettres de France.
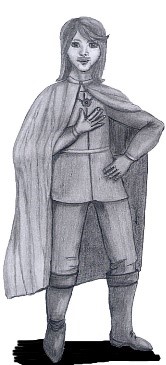
C’est ainsi que commencent généralement les contes de fée destinés aux enfants.
Bien sûr, bien sûr, mais… On ne nous dit pas tout !
Posons-nous les bonnes questions :
Qu’avait donc fait ce « gentil prince charmant » pour mériter un tel sort ?
Était-il vraiment beau, gentil et charmant ? Ah !…
Et la sorcière était-elle vraiment méchante ?
Et était-ce vraiment une sorcière ? Ha !…
Il était, autrefois, des contes destinés aux grandes personnes dont on a fait disparaître toutes les éditions, car, jugés discriminatoires, ils ont été censurés et définitivement interdits par ces mêmes censeurs qui, n’en doutons pas, n’avaient, pour la plupart, pas la conscience tranquille… Ces atroces faits divers furent repris et transformés en contes de fée pour faire peur aux petits enfants.
Il est grand temps de rétablir la vérité. Alors, reprenons :

Il était une fois, dans un sérail dont le maître était un affreux sultan barbu et adipeux, une jeune, belle et intelligente princesse.
Enfermée nuit et jour au sommet d’une tour, elle soupirait en regardant l’horizon sans fin.
Elle rêvait, la belle, à sa délivrance prochaine, se voyait, voguant sur des flots bleus à bord d’une embarcation aux voiles blanches gonflées par la brise légère, vers une contrée lointaine où l’attendait le gentil prince charmant, beau et intelligent !
Elle n’avait, pour compagnie, qu’un couple de tourterelles dont les frou-frous amoureux emplissaient l’air du matin au soir, un vieux figuier qui, allez donc savoir comment, avait pris racine sur la bordure d’une minuscule terrasse et dont les branches tordues abritaient un petit peuple de reinettes dont les croa-croa rythmaient les roucoulements des oiseaux.
Pris comme ça, sur le vif, ce tintamarre de basse-cour n’était que de très loin harmonieux, il faut bien le reconnaître. Mais la jeune fille accompagnait ces chants monocordes de sa belle voix suave en faisant courir habilement ses longs doigts effilés sur les cordes de sa harpe.
Un récital enchanteur s’élevait alors du sommet de la tour, faisant lever la tête aux passants, tout en bas, dans les ruelles, étonnés et ravis par cette douce musique qui donnait à certains comme une mélancolie et leur tirait des soupirs longs comme un jour sans fin.
On allait même jusqu’à penser qu’il y avait là quelque chose de mystérieux, voire d’angélique !
Un jour, la douce mélodie enchanteresse se tut. Le silence se fit dans la tour et les passants, dans les ruelles, hochaient tristement la tête et soupiraient encore en se disant que quelque chose de néfaste avait fait fuir les anges musiciens…
Pendant ses longues nuits solitaires, la petite prisonnière était visitée par un rêve. Sa nourrice, en réalité sa marraine – et donc une de ces fées qui, à cette époque et dans cette contrée se penchaient sur le berceau des jeunes princesses et veillaient sur elles jusqu’à leur majorité – venait l’encourager à supporter patiemment sa captivité, lui promettant un avenir meilleur. Elle se penchait sur elle et lui susurrait à l’oreille des paroles dont, au réveil, elle avait tout oublié, se souvenant seulement que, le moment venu, tout ceci lui apparaitrait clairement pour son plus grand bien.
Ce jour-là, alors que son geôlier avait mal refermé la lourde porte cloutée qui la retenait prisonnière, la jeune princesse, curieuse et excitée, jeta un rapide coup d’œil par l’entrebâillement. Personne, pas un bruit… Elle fit un pas, puis deux hors de sa chambre et, glacée de peur et très peu vêtue, s’aventura dans les couloirs du sérail où, heureusement, elle ne rencontra âme qui vive.
Ses fins bas de soie laissaient deviner ses jambes gracieuses et un voile de mousseline rose ne cachait de sa nudité que le strict minimum, mais elle préservait sa pudeur en enveloppant de son abondante chevelure dorée ses deux seins ronds aux mamelons fièrement dressés.
Afin de ne pas éveiller l’attention de ses gardes, elle ôta ses jolies mules dont les talons faisaient résonner le sol dallé, et, ainsi peu équipée, elle traversa courageusement une longue enfilade de couloirs déserts, de pièces aux décors somptueux de mosaïques, d’ors et de marbres ; elle descendit des escaliers en colimaçon et, d’étage en étage, tantôt marchant prudemment en rasant les murs, tantôt sautillant sur ses petits pieds potelés, elle arriva tout en bas de la haute tour où elle avait passé tant d’années, seule et désespérée.
Ses pas l’avaient conduite dans un endroit magnifique qui la laissa béate d’admiration et d’étonnement.
De multiples colonnades torsadées, des voûtes gracieuses, semblaient soutenir comme à bout de bras un plafond aussi haut que celui d’une cathédrale. Le sol de marbre blanc luisait comme un miroir. Au centre de l’édifice, un grand bassin dont l’eau transparente reflétait les feux multicolores d’une baie aux vitraux colorés que le soleil allumait de mille éclats.
Cet endroit sentait les délices, les plaisirs, la volupté. Était-ce un lieu de perdition pour les jeunes innocentes imprudentes ?
Comment cette enfant, pure et vierge, aurait-elle pu se douter un seul instant du danger dans lequel elle venait de se précipiter ? Comment, je vous le demande ?
Toujours est-il qu’à peine avait-elle soulevé le couvercle d’une grande malle qui trônait là, au bord du bassin, tentatrice de la plus puérile des curiosités, qu’elle en ait extrait le plus bel atour qu’elle eut pu espérer, apparut, dans l’encadrement d’une porte dérobée, le plus inattendu, le plus hideux, le plus effrayant personnage qu’une jouvencelle put avoir le malheur de rencontrer !

le plus effrayant personnage qu’une jouvencelle put avoir le malheur de rencontrer !
Vêtu d’une longue tunique jaune d’or, d’un curieux pantalon bouffant rouge sang, coiffé d’un turban vert surmonté d’une énorme pierre aussi rouge que son pantalon, chaussé de babouches aussi vertes que son turban, le bonhomme ressemblait à s’y méprendre à un gnome grimaçant et barbu, aussi large que haut, tel un petit tonneau sur pattes !
D’une voix grinçante comme une porte mal graissée, il s’exclama, coléreux, en découvrant l’intruse :
« En voilà une effrontée ! Qui t’a permis, jeune esclave, d’entrer dans mon palais ? De quel droit as-tu quitté cette tour où tu étais enfermée en attendant le jour où Moi, Grand Vizir parmi les Grands, j’aurais décidé de t’en faire sortir ?»
Effrayée tant par la vue du petit homme que par ses paroles, gênée de se montrer aussi peu vêtue à cet affreux personnage, la belle cacha tant bien que mal sa nudité à l’aide de la robe de soie trouvée dans la malle. Cependant, entendant ce nabot se qualifier de grand, elle ne put s’empêcher de penser qu’il avait de lui-même une bien plus haute opinion que sa taille n’aurait dû le lui permettre ! Elle le trouva plutôt drôle et se dit que, perdue pour perdue, le mieux était de l’amadouer.
« Monsieur le Grand Vizir parmi les Grands, dit-elle en minaudant – et en appuyant exagérément sur le mot grand – pardon. Je m’ennuyais, seule au sommet de la tour. J’ai voulu prendre l’air, visiter votre beau palais. Oh, s’il vous plaît, ne me punissez pas. Permettez-moi juste de prendre un bain dans l’eau pure de ce beau bassin. Après, je vous le promets, je retournerai sagement dans ce bel appartement que vous avez eu la grande bonté de me donner et j’attendrai patiemment votre bon vouloir pour en sortir ».
Tout ceci énoncé de la voix la plus suave, avec le plus beau sourire et les plus séduisants battements de cils dont une fille a le secret quand elle désire plaire.
Tel le corbeau sur son arbre perché, le vizir, flatté et alléché par tant de grâce, fondit comme neige au soleil et, d’une petite voix étranglée qui se voulait encore ferme, il lui donna l’autorisation qu’elle sollicitait :
« Bon, je te pardonne pour cette fois. Allez, baigne-toi et retourne vite fait dans ta tour ou, si je te vois encore traîner par ici, par les cornes du grand tentateur, je te donne en pâture aux soldats de ma garnison ! »
Ce disant, le vieux satyre, sans doute encouragé par les minauderies de l’innocente coquine, sentit monter en lui comme une fièvre et, n’y tenant plus de lorgner ce jeune et vigoureux corps désormais complètement nu, puisque la belle avait tout naturellement laissé glisser à terre son léger vêtement pour entrer dans le bain, avant qu’elle n’ait pu seulement esquisser un plongeon, il se précipita sur elle et la saisit à bras le corps.
« Cette jouvencelle est destinée à mon fils, pensait-il, mais après tout, c’est moi, ici, le Grand Vizir. Et j’ai le droit de goûter avant quiconque aux fruits de mon jardin ! »
N’ayant jamais eu à subir les assauts d’un homme et totalement ignorante des intentions salaces de celui-ci, elle crut, la pauvrette, que le vieux bonhomme, pris de remords pour l’avoir si sévèrement traitée, désirait se faire pardonner par une cajolerie affectueuse, à l’instar de sa nourrice quand elle l’avait grondée jusqu’à la faire pleurer. Elle le laissa donc faire gentiment, lui rendant même un baiser sur sa joue hirsute ; son absence de résistance et son apparent consentement donnèrent des ailes au vieillard. Tout émoustillé, il saisit un des mamelons de la belle et se mit à téter goulument et à mordiller le joli petit téton, si rose qu’il ressemblait à une fraise bien mûre.
Le chatouillis ainsi provoqué étonna autant qu’inquiéta la gamine. Jamais nourrice ne lui avait fait entrevoir ce genre de caresse. Que voulait donc ce vieux vizir ?
Comme l’autre, la serrant fort enlacée s’enhardissait un peu plus loin, la mignonne réussit à dégager un bras de cette étreinte et, sans trop savoir pourquoi, elle glissa une petite main habile jusqu’à l’échancrure du pantalon bouffant et gonflé d’où s’échappait une soudaine et turgescente érection. Saisissant au hasard ce qui lui semblait le plus accessible, elle se mit à tirer dessus en débitant des paroles qui, elle le réalisa plus tard, n’étaient autres que celles prononcées par sa nourrice dans ses rêves.
Une chose incroyable se produisit alors.
Un « ploc » accompagné d’un éclair aveuglant, une décharge électrique et… Pouf ! Le vizir lubrique disparut, comme ça, d’un seul coup !
« Alors ça, quand même, se dit la princesse, que s’est-il passé ? Et où a donc disparu ce Grand Vizir parmi les Grands ? »
Lorsqu’un « croa-croa » désespéré attira son attention. A ses pieds, un énorme et hideux crapaud vert couvert de pustules jaunes sautillait maladroitement au milieu des vêtements du grand vizir tombés en vrac à terre et la regardait de ses gros yeux globuleux avec comme un air de reproche.

« Regarde, semblait-il lui dire, regarde ce que tu m’as fait ! »
Elle n’en croyait pas ses yeux …
« C’était donc ça, se dit-elle, ce que ma marraine voulait me faire comprendre ! »
Et toutes les paroles prononcées dans ses rêves lui revinrent alors clairement.
Je ne peux ici vous les rapporter, car certaines formules magiques, comme vous pouvez le constater, ne peuvent être mises entre les mains de n’importe qui. Ce serait vraiment trop dangereux !
La belle comprit qu’à partir de ce jour, elle était investie d’un grand pouvoir sur les Grands Vizirs parmi les Grands et même, probablement, sur les hommes en général…
Elle plaça le crapaud-Grand Vizir dans une des babouches qui lui servirait désormais de lit et partit le déposer dans la chambre au sommet de la tour, dans laquelle elle était restée si longtemps prisonnière. Elle lui dit :
« A ton tour, Grand Vizir parmi les Grands, de goûter aux tourments de l’ennui. Tu ne seras pas seul. Je te laisse en compagnie de mes amies les tourterelles et les reinettes. Tâche de ne pas leur faire de misères, où tu auras affaire à moi ! ».
Se passant gourmandement la langue sur les lèvres comme pour savourer sa victoire, elle jubila :
« Que c’est bon, d’avoir un tel pouvoir ! »…
L’histoire ne nous dit pas ce qu’il advint de la belle après ces évènements, ni du fils du grand vizir à qui elle était destinée. Mais on entendit dire qu’elle rencontra, de retour dans la salle au bassin, le jeune homme sortant du bain seulement vêtu d’un étrange caleçon qui laissait déborder de tous côtés de sa personne une énorme bedaine et de généreux bourrelets graisseux.
« Tiens, se dit-elle en l’apercevant, voici sans aucun doute le fils du grand vizir ! Par le Prophète ! Il est aussi laid que son père ! »
Le garçon resta coi et béat de stupeur devant cette apparition inattendue. La belle, ne lui laissant pas le temps de se ressaisir, s’approcha, tentatrice et félonne. Ce qui devait arriver arriva ! Le pauvre bougre, dans tous ses états, ne put résister à une telle aubaine et, saisissant l’occasion à bras le corps, il subit à son tour et sans méfiance la malédiction qu’avait connue son malheureux père qu’il rejoignit dans le vieux figuier !
Mais il ne s’agit là que de on-dit que l’histoire n’a pas permis de vérifier…
Ce qui est à peu près certain, c’est que la belle se rendit ensuite au harem où elle rencontra les autres jeunes prisonnières auxquelles elle confia son secret et s’en fit des amies dévouées ; qu’ensemble, elles mirent le palais sens dessus-dessous ; qu’elles furent aidées par les eunuques, mis dans la confidence et trop contents de se venger de ces maîtres qui les avaient si maltraités ; que tous les hommes du palais et même certaines femmes succombèrent à leurs charmes ; que ceux et celles qui refusèrent leurs avances furent chassés et échappèrent ainsi au sort des autres, dont on n’en sut pas plus que ça, mais qu’il s’était produit, en une journée, des évènements terribles dont il valait mieux ne pas parler…
Mais il se dit aussi, dans toute la région, que le palais serait hanté…
Chaque soir, à la tombée du jour, on entend, à des kilomètres à la ronde, un drôle de concert dont la musique, allant du croassement le plus grave au croassement le plus aigü, a fait déserter le village de tous ses habitants qui ne pouvaient supporter un tel vacarme…
On dit que le grand vizir, son fils, sa suite, ses concubines et toute sa garnison ont disparu mystérieusement, comme ça, au beau milieu d’une journée ordinaire…
On dit que depuis, le palais est envahi par une colonie de crapauds et de grenouilles dont le nombre serait égal à celui des humains qui y vivaient autrefois…
On dit aussi qu’on a vu, la nuit suivant ce jour ordinaire où s’étaient produits ces évènements extraordinaires, une troupe de jeunes cavalières légèrement vêtues quitter le palais à brides abattues…
On dit enfin que, sur une île au large, vivent des beautés nues, dont les chants attirent les navigateurs imprudents que personne ne revoit jamais et que, lorsque la nuit tombe, des croassements lugubres accompagnent les voix harmonieuses de ces beautés qui se baignent et se prélassent sur la plage de sable blond en compagnie de quelques beaux et jeunes hommes, des princes charmants, sans nul doute, qu’elles tiennent en esclavage…
Et finalement, on ne dit rien sur les reinettes et les grenouilles mais on dit que tout crapaud ne serait autre qu’un homme laid et lubrique à qui la belle aurait jeté un terrible sort dont il ne pourrait être guéri que par le baiser chaste et amoureux d’une jeune pucelle…
Croyez-vous vraiment qu’une fille belle et intelligente, même si elle est chaste et vierge, aurait l’idée de tomber amoureuse d’un crapaud ?
Moralité : pour devenir prince charmant, mieux vaut être jeune, beau et intelligent que vieux, laid et bête… ! Bien entendu, si on est un peu riche, ça peut aider.
C’est ainsi que les contes de fée qui racontent aux enfants la mésaventure d’un jeune prince beau, riche, intelligent et amoureux d’une jeune princesse, belle, riche, intelligente et amoureuse, auquel une méchante sorcière vieille, laide et jalouse aurait jeté un sort sont à prendre avec beaucoup de prudence, car la vérité n’est pas toujours celle qu’on croit…
Ce qui n’empêche que des fois, les sorcières laides et jalouses et même pas vieilles…Mais ça, c’est une autre histoire.
retour Nouvelles
****************************************************************************************
****************************************************************************************